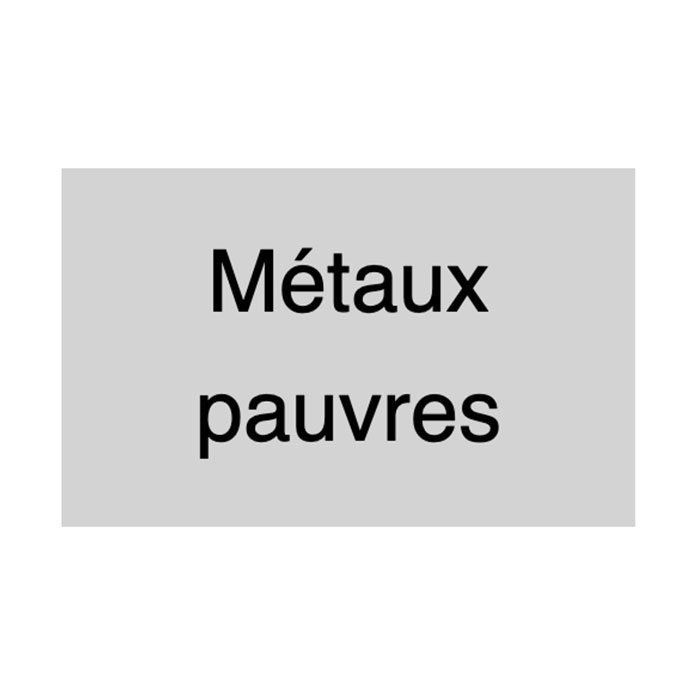
Caractéristiques des métaux pauvres
- Les métaux pauvres ont souvent une faible résistance mécanique.
- Ils ont généralement des points de fusion plus bas que les métaux de transition.
- Leur structure cristalline est décrite par un caractère plus marqué.
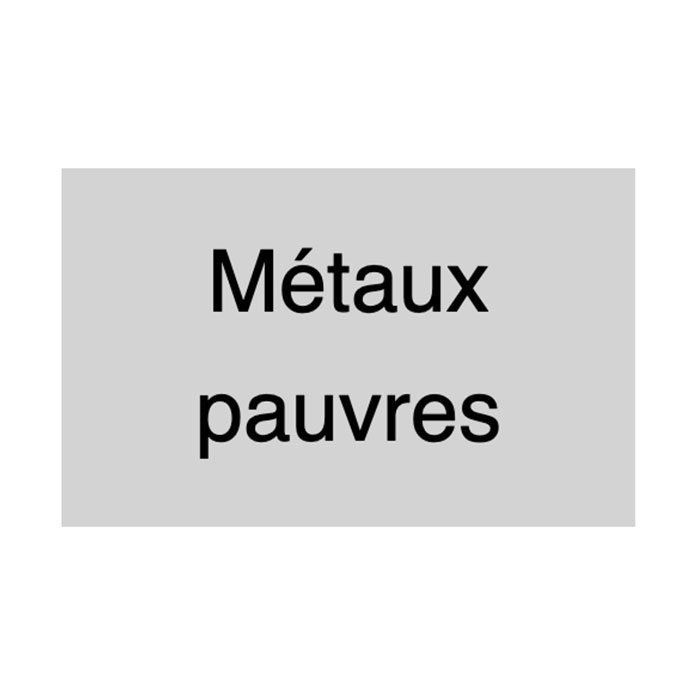
En chimie, un métal pauvre est un élément chimique qui possède des propriétés métalliques. Dans le tableau périodique, les éléments chimiques métalliques ont, à leur gauche, les métaux de transition et à leur droite, les métalloïdes. Il est parfois appelé métal post-transitionnel ou métal de post-transition. L’appellation « métal pauvre » n’est pas souvent utilisée. D’autres termes peu courants sont en concurrence avec elle pour désigner des concepts similaires, comme le métal du bloc p. Cela reflète le fait que les propriétés métalliques de ces éléments sont les moins prononcées parmi tous les métaux. Le terme « métal pauvre » est utilisé car il n’y a pas de terminologie approuvée par l’IUPAC pour décrire de manière générale les éléments ayant ces caractéristiques.
Les métaux pauvres ont souvent une faible résistance mécanique. Ils ont généralement des points de fusion plus bas que les métaux de transition. Leur structure cristalline est décrite par un caractère plus marqué. Comparée aux autres éléments métalliques, celle-ci présente des compositions plus complexes. En plus, le nombre de leurs liaisons par atome est réduit. Leur propriété chimique est en partie caractérisée par leur facilité à former des liaisons covalentes : amphotère acide/basique. Ainsi, ces éléments ont tendance à former des espèces anioniques. Par exemple, l’aluminium a la possibilité de fournir les alumates. L’étain et le bismuth tendent à composer respectivement les stannates et les bismuthates. Avec un métal alcalin ou un métal alcalino-terreux, les métaux pauvres peuvent aussi engendrer des phases de Zintl, tels les composés intermétalliques NaTl et Na2Tl.

En général, les métaux pauvres regroupent le gallium 31Ga, l’indium 49In, l’étain 50Sn, le thallium 81Tl, le plomb 82Pb et le bismuth 83Bi.
Même si l’aluminium 13Al est considéré comme un métalloïde, il est également rangé parmi les métaux pauvres.
La chimie du polonium 84Po s’apparente à celle du tellure qui est un métalloïde. Pourtant, à l’exception de sa radioactivité, ses propriétés physiques sont de plus en plus semblables à celles des métaux pauvres.
La définition des éléments de transition par l’IUPAC classe tout, ou une partie des éléments du 12e groupe, dans les métaux pauvres. Cela concerne le zinc 30Zn, le cadmium 48Cd, le mercure 80Hg et le copernicium 112Cn. Toutefois, de très nombreux ouvrages incluent ces substances dans les métaux de transition. Par conséquent, ces derniers peuvent être associés aux éléments du bloc d, tout en traitant à part les lanthanides et les actinides.
Si on considère la définition des métaux pauvres par l’IUPAC, le cas du copernicium et celui du mercure peuvent être discutés. Dans des conditions expérimentales très particulières, il est possible d’observer le fluorure de mercure (IV) HgF4, un composé du mercure à l’état d’oxydation +4. Au cas où des électrons de la sous-couche 5d seraient impliqués, le mercure peut devenir un métal de transition. Ce constat n’est qu’une observation incertaine et isolée, car selon la chimie du mercure, ce dernier reste un métal pauvre.
Par contre, il serait probable que le copernicium soit un métal de transition. Dans son cas, les orbitales 7s et 6d jouent un rôle important dans la structure électronique de l’atome. Les orbitales 7s ont une énergie plus élevée que les orbitales 6d, mais en raison d’effets relativistes, leur énergie diminue. Cela a pour résultat la stabilisation des orbitales 7s par rapport aux orbitales 6d. La configuration de l’ion Cn2+ serait alors [Rn] 5f14 6d8 7s2 et engendrerait une sous-couche 6d incomplète. Par conséquent, en solution aqueuse, le copernicium serait à l’état d’oxydation +2 et même +4.
Le flérovium a été initialement identifié comme ayant les propriétés de gaz noble. Pourtant, il est le seul élément de la 7e période à avoir été caractérisé comme métal pauvre. Il reste ainsi le composant à nature chimique indéterminée. L’existence de métaux pauvres parmi les constituants du bloc p dans cette période est possible. Cependant, les études sur leurs propriétés chimiques ont été insuffisantes pour pouvoir les identifier.
L’existence des allotropes aux diverses propriétés rend généralement délicate la classification d’un élément dans une famille. Le cas de l’étain en est un exemple. D’une part, il présente les métalloïdes voisins d’un non-métal. En effet, d’un côté, il dispose d’une phase α grise, ayant une structure cubique, de type diamant. Celle-ci est stable à des températures basses. D’un autre côté, l’étain a une phase β blanche dont la structure est tétragonale. Cette dernière a les propriétés d’un métal pauvre. À température ambiante, elle est stable. L’étain est globalement vu comme un métal pauvre.
| Élément | Masse atomique | Température de fusion | Température d’ébullition | Masse volumique | Rayon atomique | Configuration électronique | Énergie d’ionisation | Électronégativité (Pauling) |
| Gallium | 69,723(1) u | 29,771 °C | 2 204 °C | 5,91 g·cm-3 | 135 pm | [Ar] 4s2 3d10 4p1 | 578,8 kJ·mol-1 | 1,81 |
| Indium | 114,818(1) u | 156,60 °C | 2 072 °C | 7,31 g·cm-3 | 167 pm | [Kr] 5s2 4d10 5p1 | 558,3 kJ·mol-1 | 1,78 |
| Étain | 118,710(7) u | 231,93 °C | 2 602 °C | 7,27 g·cm-3 | 140 pm | [Kr] 5s2 4d10 5p2 | 708,6 kJ·mol-1 | 1,96 |
| Thallium | 204,383 5 u | 304 °C | 1 473 °C | 11,85 g·cm-3 | 170 pm | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1 | 589,4 kJ·mol-1 | 1,62 |
| Plomb | 207,2(1) u | 327,46 °C | 1 749 °C | 11,34 g·cm-3 | 175 pm | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2 | 715,6 kJ·mol-1 | 1,87 |
| Bismuth | 208,980 40 u | 271,40 °C | 1 564 °C | 9,78 g·cm-3 | 156 pm | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p3 | 703 kJ·mol-1 | 2,02 |
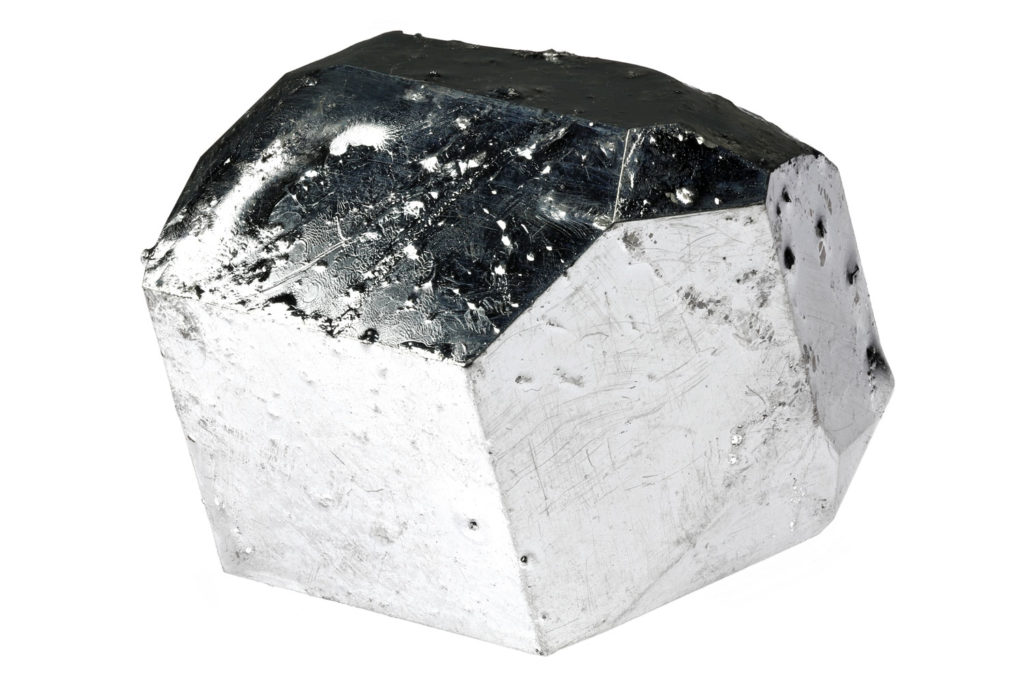
L’aluminium a une masse atomique de 26,981 538 5 u. Sa température de fusion et d’ébullition sont respectivement de 660,32 °C et de 2 519 °C. Sa masse volumique est de 2,70 g·cm-3 et son rayon atomique de 143 pm. Sa configuration électronique, son énergie d’ionisation et son électronégativité, selon l’échelle de Pauling, sont successivement [Ne] 3s2 3p1, 577,5 kJ·mol-1 et 1,6.
Le zinc a une masse atomique de 65,382 u et une température de fusion de 419,53 °C. Sa température d’ébullition est de 907 °C. Il a une masse volumique de 7,14 g/cm³. Son rayon atomique est de 134 pm. Sa configuration électronique est de [Ar] 4s2 3d10 et son énergie d’ionisation, de 906,4 kJ/mol. Suivant l’échelle de Pauling, 1,65 est son électronégativité.
Le cadmium a une masse atomique de 112,414(4) u, une température de fusion de 321,07 °C et une température d’ébullition de 767 °C. Sa masse volumique est de 8,65 g·cm-3 et son rayon atomique de 151 pm. Sa configuration électronique est [Kr] 5s2 4d10 et son énergie d’ionisation, 867,8 kJ·mol-1. Son électronégativité, à l’échelle de Pauling, est de 1,69.
La masse atomique du mercure est de 200,592(3) u. Sa température de fusion et d’ébullition sont successivement −38,83 °C et 357 °C. Il a une masse volumique de 13,53 g·cm-3. Son rayon atomique est de 151 pm. Sa configuration électronique, son énergie d’ionisation, selon l’échelle de Pauling, sont respectivement [Xe] 6s2 4f14 5d10, 1 007,1 kJ·mol-1 et 2,00.
Les propriétés physiques du polonium sont les suivantes :
Toutes les données concernant le flérovium proviennent des calculs sur la base des modèles numériques existants. Sa masse atomique est de [289]. Sa température de fusion et d’ébullition sont respectivement de 67 °C et de 147 °C. Sa masse volumique est de 14 g·cm-3 et son rayon atomique de 180 pm. Sa configuration électronique et son énergie d’ionisation sont successivement [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p2 et 823,9 kJ·mol-1.