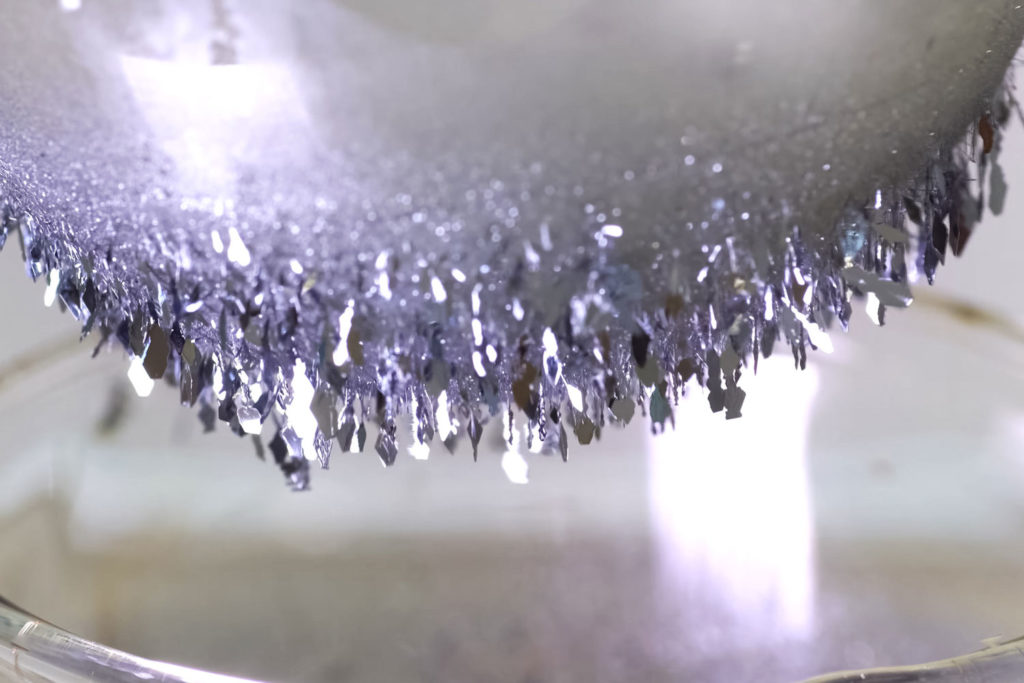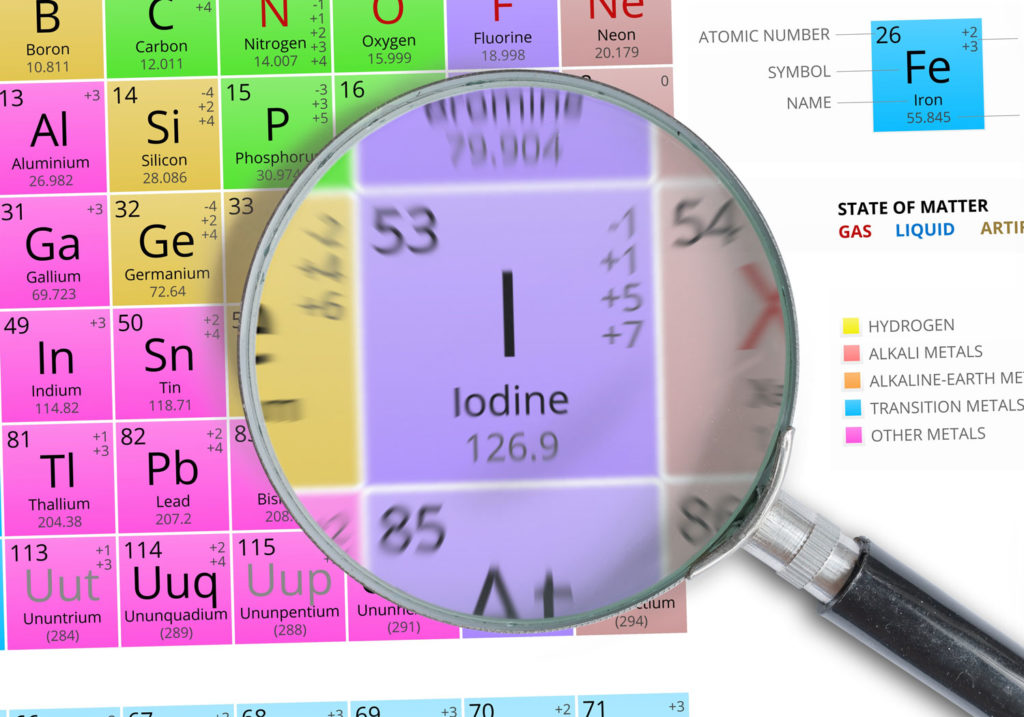Caractéristiques du iode
- Symbole : I
- Masse atomique : 126,904 47 ± 0,000 03 u
- Numéro CAS : 14362-44-8(élément) 7553-56-2 (diiode)
- Configuration électronique : [Kr] 4d10 5s2 5p5
- Numéro atomique : 53
- Groupe : 17
- Bloc : Bloc p
- Famille d’éléments : Halogène
- Électronégativité : 2,66
- Point de fusion : 113,7 °C