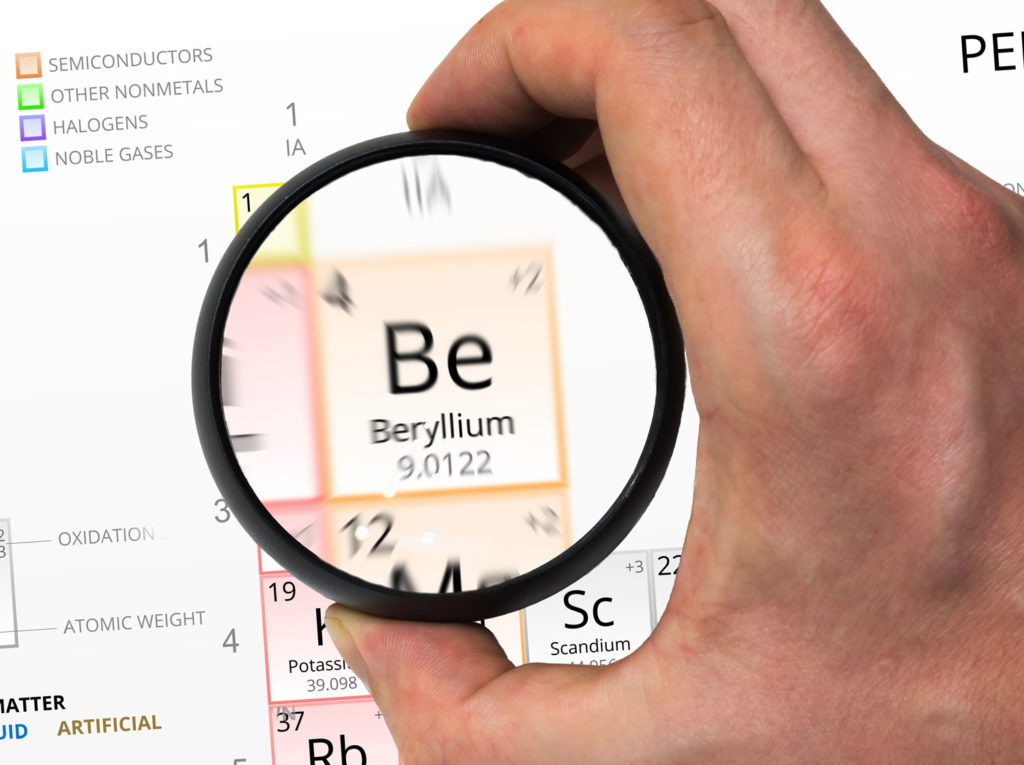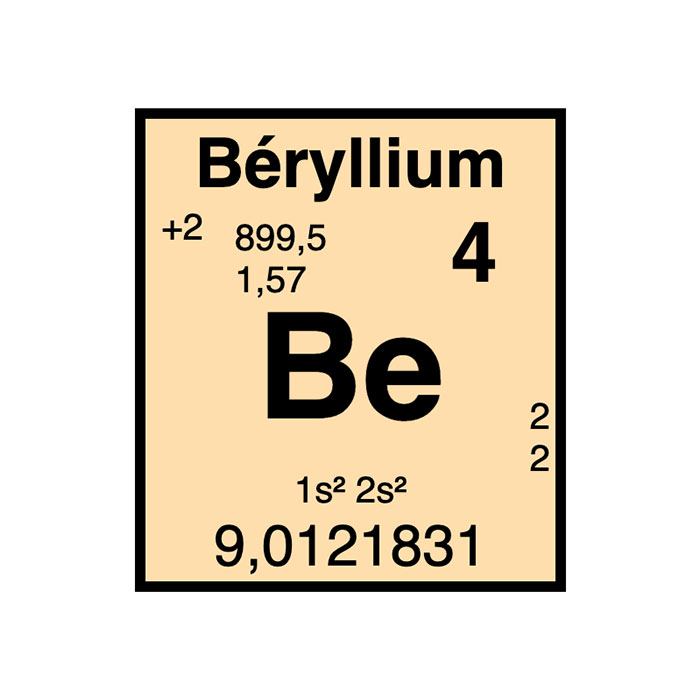
Caractéristiques du béryllium
- Symbole : Be
- Masse atomique : 9,012 u
- Numéro CAS : 7440-41-76
- Configuration électronique : [He]2s2
- Numéro atomique : 4
- Groupe : 2
- Bloc : Bloc S
- Famille d’éléments : Métal alcalino-terreux
- Électronégativité : 2,2
- Point de fusion : 1 287 °C3