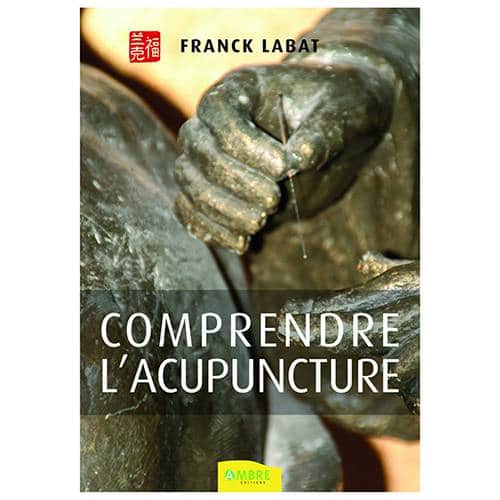Associations synergiques de la valériane
Pour calmer la nervosité, la valériane peut être associée à la passiflore et l’aubépine. La valériane agit efficacement sur le stress, l’anxiété et le trouble du sommeil en synergie avec la mélisse et l’escholtzia.
Le millepertuis et la valériane agissent contre les anomalies du sommeil, une légère dépression et des troubles de l’humeur. Pour aider à arrêter de fumer, le bon duo est composé du kudzu et de la valériane.
Contre-indications, effets indésirables et précautions d’emploi
Avant toute utilisation thérapeutique de la valériane ou avant de commencer une cure, il est conseillé de demander un avis médical. Pour l’emploi de l’huile essentielle, il est recommandé de faire un test préalable sur le pli du coude 48 heures.
La prise de valériane est contre-indiquée chez les personnes en insuffisance hépatique. La femme enceinte ou allaitante ainsi que les enfants de moins de douze ans doivent s’abstenir de cure à base de valériane.
Les effets secondaires de la valériane sont rares : douleurs abdominales, nausées, maux de tête et vertiges. Les traitements de plus de six semaines ont rapporté des insomnies. Le manque peut s’installer après une interruption soudaine de la cure. Les symptômes se manifestent par de l’agitation et des palpitations.
La valériane entraîne une baisse de vigilance par ses effets sédatifs. Il est donc déconseillé de conduire des véhicules et des engins, ou de manipuler des matériels dangereux après sa consommation.
La valériane provoque une somnolence lorsqu’elle est prise en même temps que les médicaments suivants :
- des somnifères,
- des antidépresseurs,
- des tranquillisants,
- des antitussifs,
- des antalgiques,
- des antihistaminiques H1,
- des antiépileptiques.
Cette réaction se produit également lors de sa prise avec de l’alcool.
La combinaison de la valériane avec des médicaments anticoagulants majore le risque d’hémorragie. D’autres interactions de la valériane peuvent être observées avec les médicaments sollicitant le foie et les compléments en fer. En effet, la valériane diminue l’absorption intestinale de fer.
La valériane augmente l’action sédative de plusieurs plantes : la menthe pouliot ;
- la mélisse ;
- la camomille ;
- le houblon ;
- la passiflore ;
- la consoude officinale ;
- le kava ;
- le petit chêne ;
- la germandrée ;
- la scutellaire ;
- le millepertuis.
Les avis des autorités de santé
L’European Medicines Agency recommande la valériane pour réduire les troubles du sommeil et la tension nerveuse légère. Elle reconnaît l’utilisation de la plante comme scientifiquement établie.
L’Organisation Mondiale de la Santé valide l’aptitude de la valériane à améliorer le sommeil et la considère comme un faible tranquillisant.
La Commission E allemande conseille la valériane en cas de troubles de l’endormissement et d’agitation associés à la nervosité.
L’European Scientific Cooperative On Phytotherapy accepte la valériane dans le traitement des tensions nerveuses et des troubles de l’endormissement.
Les National Institutes of Health approuvent l’utilisation de la valériane dans les troubles du sommeil. Ils sont plus réticents vis-à-vis de son emploi en cas d’anxiété. Par contre, ils refusent son utilisation comme calmant, surtout dans l’épilepsie.