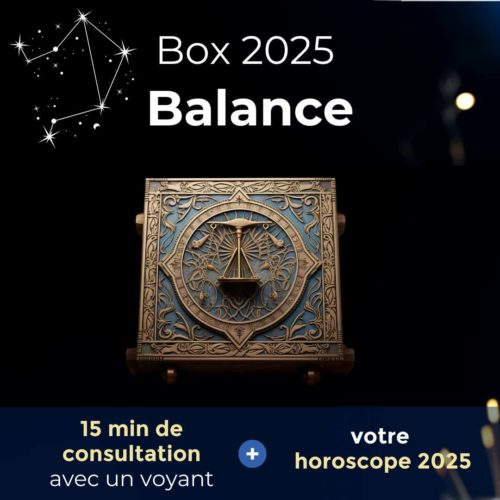Histoire du lithothamne
La première découverte du lithothamne remonte à l’ère du crétacé. Très ancienne, cette algue trouve son utilité auprès des agriculteurs depuis plus de 50 ans, pour alcaliniser le sol et le rendre plus fertile. Depuis des décennies, les vétérinaires en font également usage pour fortifier les animaux en pâture durant les périodes d’épidémie.
Selon les chercheurs, le Phymatolithon calcareum a une vie dite non fixée. En d’autres termes, il a la possibilité de s’épanouir dans différents emplacements sous la mer, pour ensuite s’en détacher naturellement à maturité. En effet, une fois mature, il est ramassé au large des côtes.
Cette algue croît et se récolte principalement en Atlantique, notamment au large du Finistère, sur les côtes bretonnes. Toutefois, elle se rencontre également sur les côtes méditerranéennes et celles de la Manche, tout comme sur les rives brésiliennes. Elle se retrouve de même dans la Mer du Nord, particulièrement en Norvège, en Irlande et en Angleterre. Sur les côtes bretonnes où il est protégé, le lithothamne constitue essentiellement le maërl. Il s’agit d’un milieu marin constitué d’accumulation d’algues calcaires.
Spécificités du lithothamne
Mise à part sa couleur rouge qui vire au rose violacé, cette algue est facilement reconnaissable par son apparence rocailleuse. Sa longueur avoisine les sept centimètres, et son épaisseur varie de deux à quatre millimètres. Elle se démarque par ses ramifications grossièrement sphériques.
Si le lithothamne est d’une consistance pierreuse, c’est parce qu’il se développe sur des fonds marins. En plus d’être immergé, il est incrusté de calcaire, raison pour laquelle il est très riche en minéraux tirés de l’eau de mer. Comme il cristallise ces substances dans un environnement très agité et fortement oxygéné, il est donc naturellement sédimentaire.
Bien qu’il soit constitué d’innombrables oligoéléments, il n’y a que sa partie minéralisée qui est récoltée. En effet, la partie vivante est laissée intacte pour ne pas compromettre le développement du Phymatolithon calcareum. Le lithothamne est doté d’un thalle très calcifié, composé jusqu’à 80 % de carbonates. Celui-ci forme de nombreuses branches d’un ton rosé et constitue des croûtes fines sur différents substrats à son jeune âge. Ces brindilles se détachent ensuite pour mener une vie non fixée, et les arbuscules détachés deviennent de nouvelles algues à leur tour. Le spécimen originel, quant à lui, meurt, vire au jaune et ressemble finalement à une pierre.