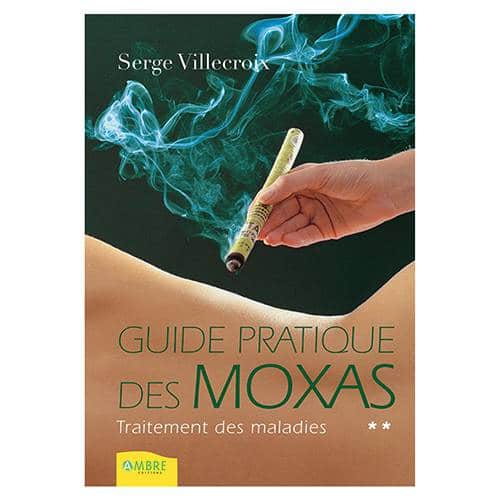Contre-indications et effets indésirables de la guède utilisée comme plante médicinale
L’isatis est contre-indiqué quand la personne est faible ou ne présente aucun symptôme spécifique. Il ne doit pas non plus être pris sur de longues périodes. Le cas échéant, cette plante risque de nuire à la digestion.
L’extrait purifié d’indirubine peut engendrer une thrombocytopénie, des troubles gastriques et parfois une dépression médullaire.
Autres utilisations de la guède
L’Isatis tinctoria est aussi connu pour être une plante fourragère, mellifère, ornementale et tinctoriale.
En tant que plante fourragère
Au XVIIIe siècle, les moutons étaient envoyés paître dans les champs de pastel après la dernière coupe d’automne. De nos jours, l’isatis est encore cultivé et destiné à l’alimentation animale.
En tant que plante mellifère
Cette plante mellifère est particulièrement appréciée des abeilles et d’autres insectes.
En tant que plante ornementale
Grâce à ses fleurs de couleur jaune vif apparaissant entre avril et mai, le pastel des teinturiers est utilisé comme plante décorative.
En tant que plante tinctoriale
Dès qu’elles commencent à jaunir, les feuilles de guède sont récoltées et subissent plusieurs traitements. Elles sont lavées, séchées et broyées de manière à donner une pâte. Une fois séchée et durcie, cette dernière est ensuite écrasée et mise manuellement en boule. Appelées « cocagnes » dans le Lauragais, ces grosses boules continuent à être séchées pendant un à deux mois. Une fois déshydratées, elles peuvent être transportées et commercialisées auprès des teinturiers pour servir à la préparation de la matière tinctoriale.
Les cocagnes sont écrasées avec des maillets et éventuellement réduites en poudre. Puis, elles sont aspergées d’eau de rivière ou d’urine pour déclencher la fermentation. Selon l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, la matière s’échauffe et fume. La pâte est régulièrement remuée à la pelle. Une fois sèche, elle donne une poudre tinctoriale de couleur noire dénommée « agranat ». Celle-ci est mise en baril ou en sac pour faciliter son transport.
La teinture bleu pastel s’obtient par oxydation du jus verdâtre obtenu à partir des granulés d’agranat. Elle donne aussi un sous-produit qui est le pigment utilisé en peinture et en dessin. Pour l’obtenir, il convient de recueillir l’écume produite lors des bains de teinture, de la sécher et de la réduire en poudre. Incorporé à du carbonate de calcium, ce pigment est employé dans la fabrication des bâtonnets, connus sous le nom de « pastels ».