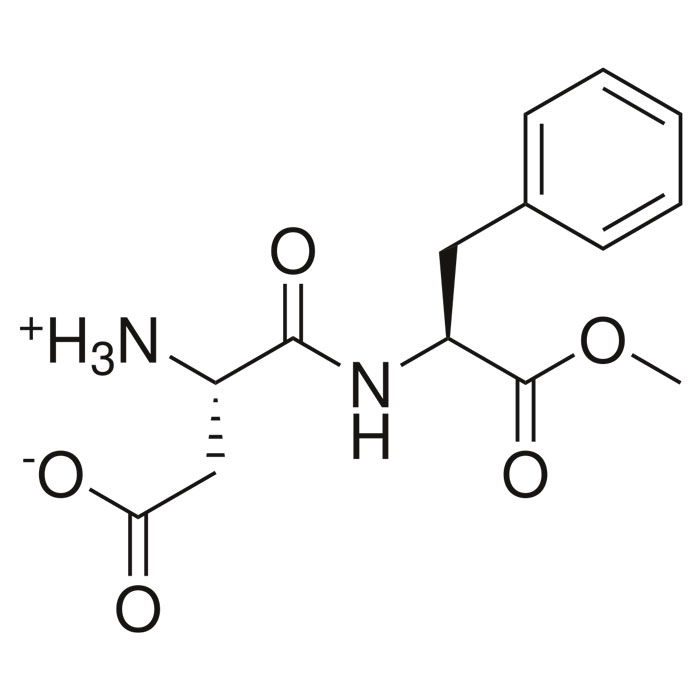Tout savoir sur l’E957 : ses caractéristiques, ses propriétés, sa purification, son historique, ses rôles, sa place en nutrition et ses effets secondaires
L’E957, connu sous le nom de « thaumatine », est largement utilisé dans l’industrie alimentaire depuis de nombreuses années. Cet additif alimentaire est considéré comme un édulcorant naturel ayant un pouvoir sucrant très élevé. Cette substance est également exploitée dans le domaine de la pharmacologie.
Description de l’E957
L’E957 se présente généralement sous la forme d’une poudre inodore de couleur crème. Il est constitué par une protéine, la thaumatine, elle-même contenant deux principales molécules, appelées « thaumatine I » et « thaumatine II ». Selon les estimations, cette protéine est 2 000 à 3 000 fois plus sucrée que le saccharose à poids égal. Lorsque la concentration en sucre (poids/volume) est supérieure, ses propriétés édulcorantes diminuent.
Cette substance est extraite de fruits, en particulier de l’arille rouge charnu du Thaumatococcus danielli, également connu sous le nom de « katemfe ». Cette plante à fleurs appartient à la famille des Marantacées, une catégorie de végétaux monocotylédones. Elle pousse dans les forêts tropicales depuis la Sierra Leone et le Nigeria jusqu’au bassin du Congo.
Propriétés de l’E957
L’E957 est extrêmement stable à la chaleur dans un environnement acide. Toutefois, cette stabilité est compromise dans un milieu alcalin. Ainsi, même si la substance a été exposée à des conditions de 80 °C à un pH égal à 2 pendant 4 h, ou à un pH équivalent à 4 durant 2 h, son goût sucré reste intact. En revanche, une exposition de 15 min à un pH égal à 7, toujours à 80 °C, fait perdre à cet additif alimentaire sa saveur sucrée.
La thaumatine présente une grande solubilité dans divers liquides et solvants. Elle est soluble dans l’eau jusqu’à 20 % (pourcentage en poids) à un pH de 3. Cette substance se dissout également jusqu’à 5 % dans des préparations à base d’éthanol à 60 % et de propylène glycol. En cas de préhydratation de la protéine, la dissolution dans de l’éthanol à plus forte concentration (jusqu’à 90 %) devient possible. Enfin, l’E957 se dissout dans le glycérol et les alcools de sucre, mais reste insoluble dans l’acétone.
Purification de la thaumatine
L’extrait de thaumatine subit un processus de purification par ultrafiltration sélective. Cependant, le produit final destiné au commerce contient encore un résidu organique non protéique. Ce dernier est principalement composé d’arabinogalactane et d’arabinoglucuronoxylane, qui sont deux constituants courants des gommes et des mucilages de diverses plantes.
La thaumatine I, l’une des deux protéines sucrantes naturelles présentes dans le katemfe, subit un processus de purification à partir d’un extrait de pulpe de fruit. Cette étape implique la mise en œuvre d’une chromatographie à échange d’ions, suivie d’une filtration par chromatographie sur gel.
Histoire de la thaumatine
La première mention de l’utilisation du fruit du katemfe remonte au XIXe siècle, bien avant que la molécule de thaumatine ne soit isolée.
Dans les années 1840, W. F. Danielli, un chirurgien de l’armée britannique, a observé que la population locale s’en servait pour rehausser le goût des fruits acides et du vin de palme. Plus tard, le naturologue britannique George Bentham a donné à l’arbre son nom latin, en hommage au chirurgien.
En 1970, la société Talin Food procéda à l’extraction de la partie sucrée du fruit. Elle mit en vente le produit sur le marché en tant qu’édulcorant sous le nom de « Talin ». Les fruits qui ont servi à cette exploitation étaient originaires d’arbres plantés en Côte d’Ivoire.
Des chercheurs d’Unilever réussirent en 1972 à isoler et à identifier les deux protéines responsables du pouvoir sucrant, à savoir les thaumatine I et II. Ils découvrirent quatre autres protéines naturelles homologues en 1984, qu’ils baptisèrent « III, a, b et c ».
Structure de la thaumatine
Cette protéine présente une distribution spécifique d’acides aminés. Ces derniers comprennent la lysine, la leucine et la valine, ainsi que des acides gras non essentiels tels que l’acide aspartique, la glycine et l’alanine.
Primaire
Les thaumatines I et II, formées d’une séquence de 207 acides aminés, sont extrêmement similaires, ne différant que par cinq acides aminés. Ces différences se situent aux positions :
- 46 (substitution de N pour K, asparagine à la place de lysine) ;
- 63 (remplacement de S par R, sérine à la place d’arginine) ;
- 67 (changement de K pour R, lysine au lieu d’arginine) ;
- 76 (substitution de R pour Q, arginine à la place de glutamine) ;
- 113 (changement de N pour D, asparagine au lieu d’acide aspartique).