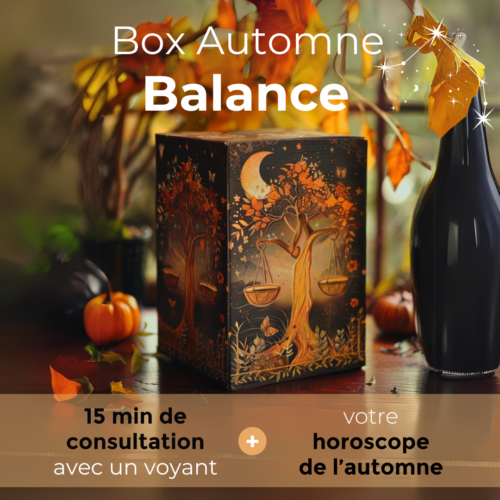Les cordes
Les cordes du violoncelle, à l’origine en boyau, sont actuellement en matériaux synthétiques. Généralement, elles sont constituées d’un filin en acier entouré d’une bobine en argent, en aluminium ou en tungstène. Leur noyau est recouvert d’or ou de chrome : ces matériaux offrent différentes nuances sonores. Un jeu de cordes coûte parfois des centaines d’euros.
Avec une utilisation régulière, elles doivent être changées environ une fois par an, et plus souvent pour les professionnels. Le luthier se charge de leur remplacement, afin de leur donner la tension recherchée, tandis que les réglages fins sont opérés par le musicien. Un nouveau jeu de cordes prend en général quelques jours avant de rendre le son définitif.
L’archet
À l’origine, la baguette de l’archet du violoncelle était faite de Paubrasilia echinata ou pernambouc, également connu sous le nom de « bois du Brésil ». Cet arbre étant en danger d’extinction, son exportation est désormais illégale. En conséquence, les fabricants utilisent désormais des matériaux alternatifs tels que la fibre de carbone, tandis que la poignée est en cuir.
La mèche de l’archet est faite de 190 à 250 crins de cheval blanc en moyenne. Les autres composants sont faits de matériaux précieux tels que l’ivoire, la nacre, le maillechort ou l’or.
L’étui
La housse de protection du violoncelle doit être non seulement légère, mais surtout solide. La plupart des étuis sont en fibre de verre et/ou en fibre de carbone.
En outre, les instruments fabriqués par de célèbres luthiers sont devenus des objets d’art particulièrement prisés, recherchés par les collectionneurs, les mécènes, les musées, etc. Niccolò Amati (1596-1684), Antonio Stradivari (1644-1737) et Matteo Goffriller (1659-1742), tous les trois italiens, ont laissé de remarquables instruments encore fonctionnels de par le monde.
Comment en jouer ?
Le joueur de violoncelle est un « violoncelliste ». Il joue assis sur un tabouret, le dos droit, les pieds bien à plat. Ses jambes sont perpendiculaires au sol, les genoux écartés encadrant la partie basse de l’instrument pour le maintenir en équilibre, sans le serrer.
L’instrument repose sur la pique, la partie haute sur la poitrine du musicien, de sorte que les clés soient à hauteur de son oreille. Si le joueur est droitier, il manie l’archet avec sa main droite, et sa main gauche joue sur la touche.
Une bonne position doit permettre au musicien :
- de bouger facilement, de droite à gauche et, légèrement, d’avant en arrière ;
- de se lever sans s’appuyer sur l’instrument et sans bouger les pieds.
Le mode de jeu principal est le frottement avec l’archet, rarement, le pincement des cordes, et encore plus rarement, la frappe avec le bois de l’archet.
L’apprentissage moderne du violoncelle repose sur le concept de « positions ». Chaque position, déterminée par la hauteur des doigts sur une corde donnée, permet d’atteindre différentes notes. La première place l’index de manière à produire une note un ton plus haut que la corde à vide.
L’extension est un déplacement des doigts pour atteindre des notes plus aiguës ou plus graves. Le démanché consiste en un déplacement de la main gauche le long du manche. Le vibrato est une ondulation expressive de hauteur produite par une oscillation du doigt.
L’aspect unique de la technique de cet instrument réside dans l’utilisation du pouce. Normalement positionné sous le manche, il émerge au-dessus de la table au-delà du la3, offrant la possibilité d’ajouter un doigt.
Comment la musique est-elle conservée ?
Les partitions pour violoncelle obéissent aux règles de transcription de la musique classique, avec quelques spécificités. Elles sont en général écrites en clé de fa.
Aperçu du solfège
Les notes sont placées sur la portée de 5 lignes, une note est soit sur une ligne, soit sur un interligne. S’il n’y en a pas suffisamment, d’autres, supplémentaires, sont ajoutées.
La clef de fa indique la position du fa sur la quatrième ligne de la portée. Toutes les autres notes sont placées en fonction de celle-ci. Rappelons que les notes sur un violoncelle sont produites par la position des doigts sur les cordes.
Les intervalles sont toujours composés de tons et de demi-tons. Les altérations (placées devant la note) baissent (bémol), montent (dièse) le son d’un demi-ton ou annulent l’effet de l’altération (bécarre).
Les mesures sont séparées par des barres, et le chiffre après la clef indique le nombre de temps (ou pulsations) par mesure. Des lettres indiquent les nuances ou puissance sonore : « p » pour piano, « m » pour mezzo et « f » pour forte.
Les symboles suivants sont spécifiques au violoncelle.
- Pousser : la position initiale de l’archet est à la pointe, puis on le pousse.
- Tirer : la position initiale de l’archet est au talon, puis on le tire.
- Double corde : les notes sont jouées sur plusieurs cordes simultanément.
- Divisi : les notes sont réparties entre plusieurs violoncellistes d’un même pupitre en orchestre. Celui de droite joue la note du haut et le musicien de gauche joue celle du bas.
- Pizzicato : la note est jouée en pinçant la corde avec un doigt de la main droite.
- Pizzicato main gauche : la note est jouée en pinçant la corde avec un doigt de la main gauche.
- Pizzicato Bartok : la note est jouée en faisant claquer et résonner la corde sur le bois de la touche avec un doigt de la main droite.
- Arco : la note est jouée avec l’archet, suite à l’indication pizzicato.
Enfin, le trémolo est une note répétée en tirant et en poussant très rapidement l’archet.
Transmission et conservation
Dans la conservation de la musique, la transmission de maître à élève joue un rôle essentiel. Les enseignants transmettent souvent des partitions annotées et de précieux conseils à leurs apprentis.
Les supports évoluent au fil du temps, des enregistrements vinyles aux CDs. Actuellement, les formats numériques permettent de mieux conserver la musique.
Les conservatoires ainsi que les musées ont pour rôle de veiller à cette transmission et à cette
conservation.
Entretien du violoncelle
Il est essentiel de faire réviser annuellement son violoncelle par un luthier. Ce dernier peut détecter d’éventuelles fissures invisibles à l’œil nu, et il restaure le vernis en cas d’accidents mineurs.
L’instrument se range dans son étui durant les périodes d’inutilisation, à l’abri du soleil et de l’humidité. En général, il est préférable de jouer avec des mains propres et sèches.
La touche nécessite des nettoyants spéciaux pour la colophane et la transpiration qui s’y déposent. Lors du changement de corde, appliquer de la craie ou un stick spécial sur les chevilles pour assurer une bonne adhérence au bois.
En outre, des vérifications régulières doivent être faites pour assurer que le chevalet ne s’est pas décollé de la table. Passer les interstices au crayon gras permet de prévenir les accrochages : le graphite favorise le glissement des cordes.