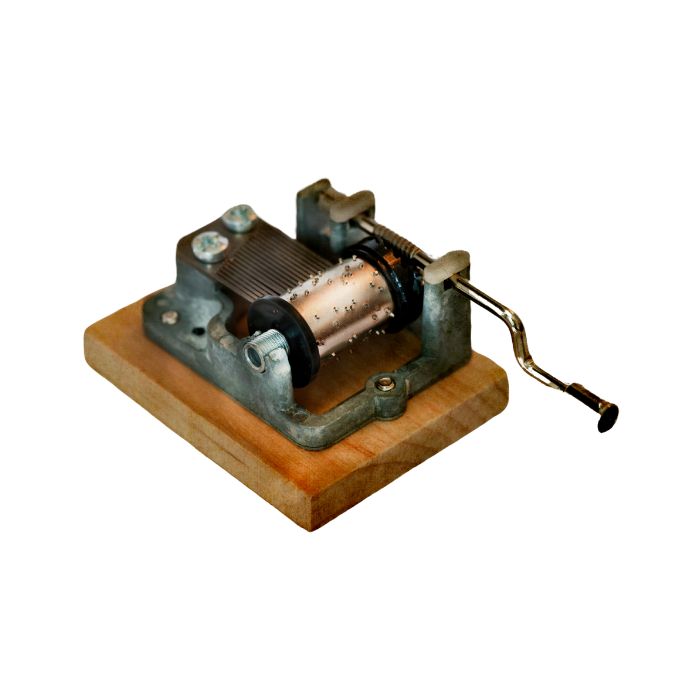Vielle à roue électrique
Les premiers modèles électriques sont équipés de plusieurs microphones qui peuvent être reliés, un à un, à des entrées d’une table de mixage. De ce fait, il est possible d’en ajouter des effets. Dans la musique pop, les vielles à roue utilisées disposent de microphones électromagnétiques. Ils ont la capacité de convertir les vibrations des cordes en signaux électriques. Ceux-ci sont ensuite envoyés à un amplificateur. Ils peuvent aussi être reproduits, puis modifiés par un synthétiseur.
Vielle à roue électronique
Les modèles électroniques ne disposent d’aucune corde. Les signaux audios numériques sont générés grâce aux touches et aux mouvements de la roue. Ils sont ensuite émis par un processeur et par une carte son contenus dans la caisse de résonance. Cette dernière peut être reliée à un synthétiseur connecté, à un échantillonneur ou à un ordinateur. La gestion des informations partagées entre les deux appareils se fait par l’intermédiaire d’une interface MIDI (système de données musicales numérisées).
Parmi les versions électroniques de cet instrument, la MidiGurdy est totalement numérique. Elle a été mise au point par Marcus Weseloh en 2014. Ce prototype a été produit jusqu’en 2021. On en recense une centaine d’exemplaires.
Jeu de la vielle à roue
Le jeu de la vielle à roue repose sur les éléments suivants :
- la pièce de bois, c’est-à-dire le chien ou la cigale ;
- la rotation de la roue ;
- la manipulation des touches.
La manivelle est actionnée par la main droite. Il se produit un mouvement rythmique. Celui-ci est régi par la variation de la vitesse de rotation de la roue et par les à-coups générés à partir de la poignée. La main gauche réalise des déplacements linéaires sur le clavier. Lorsque les touches sont enfoncées, la longueur vibrante de chaque corde est limitée par une rétraction des sautereaux. Le son est, de ce fait, plus aigu. Une fois qu’elles sont relâchées, la longueur d’échelle retrouve ses caractéristiques initiales.
Les chanterelles sont activées ensemble pour parvenir à une note spécifique. Elles sont généralement réglées à la même hauteur. Cependant, elles peuvent être accordées avec une octave d’écart et émettre un son beaucoup plus riche.
Le jeu de cet instrument implique un bon accordage, en fonction du répertoire de musique. Les chanterelles sont en do, en ré et le plus souvent en sol. Le bourdon est attribué à la note tonique de la mélodie. Le réglage des autres cordes et des dispositifs supplémentaires, comme le capodastre, permet de modifier la hauteur des notes et de jouer dans des tonalités différentes.
Achat d’une vielle à roue
Suivant votre localisation, il est possible de trouver un artisan luthier, spécialisé dans la facture de vielles à roue. Cette option est idéale si vous avez une idée préconçue du modèle que vous souhaitez acquérir. Vous pouvez ainsi opter pour un modèle personnalisé. Une autre alternative est de se tourner vers les boutiques d’instruments en ligne comme France Minéraux. Les articles qui y sont proposés sont disponibles dans un large choix de modèles neuf ou d’occasion.
Pour choisir une vielle à roue, vous avez besoin d’analyser les critères suivants :
- Le mode de fonctionnement : elle peut être acoustique (classique), électrique ou électronique.
- La tonalité : en sol, en ré ou en la. Cette indication est d’une importance capitale lorsque vous jouez en duo ou dans un ensemble. Si les notes ne sont pas les mêmes, l’instrument sonne faux. Toutefois, l’utilisation d’un capodastre permet d’accorder la vielle.
- La taille : ce critère conditionne la prise en main du cordophone. Plus il est petit, plus il est facile à jouer. Il existe même des modèles pour les enfants.
Il est tout aussi important de considérer votre budget pour que l’achat soit réussi. Si ce dernier est inférieur aux prix affichés, sachez qu’il existe des instruments en location, souvent disponibles auprès d’associations ou de groupes folkloriques. Cette option permet d’appréhender le jeu du cordophone avant de vous investir dans un achat futur.
Entretien de la vielle à roue
Avant de jouer à la vielle à roue, celle-ci doit être bien entretenue. L’une des premières opérations à réaliser est de changer le coton sur les cordes lorsque celles-ci commencent à être visibles. Bien qu’il en existe différents types, il doit être le plus filandreux possible. Il suffit de l’enrouler en le faisant tourner autour des cordes. Cette action permet d’amortir les vibrations et d’améliorer la sonorité de l’instrument.
L’entretien de la vielle à roue consiste aussi à l’application de colophane. Cette gomme est obtenue à partir de la résine sécrétée par le pin et d’autres arbres du même genre. Elle est communément utilisée sur les cordophones frottés. Elle est à étaler sur l’archet pour optimiser l’adhérence et la friction sur les cordes. Il en résulte une meilleure résonance. Dans ce cas, où cette baguette en bois est remplacée par une roue, la colophane est enduite sur cette dernière. Elle y est posée légèrement (sans pression) pour qu’elle puisse être appliquée en bonne quantité à chaque rotation. De même, il est recommandé de mettre un peu de ce produit sur les cordes avant d’enrouler le coton.