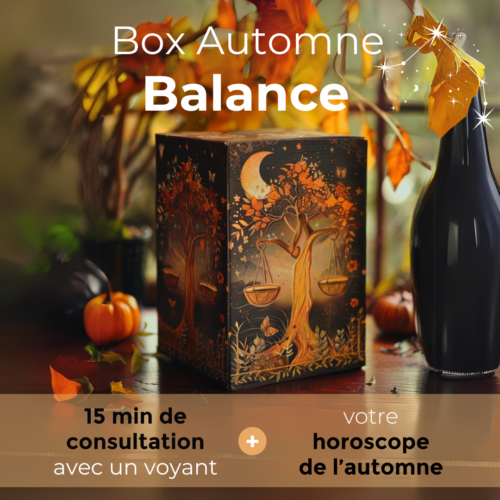La première est placée sur le sol, ouverte vers le haut et remplie d’eau, selon la tonalité souhaitée. La dimension de l’écorce de la calebasse a aussi une incidence sur la sonorité obtenue. La deuxième, plus petite, est positionnée face à l’eau, flottant avec la partie bombée vers le haut, formant ainsi la caisse de résonance.
D’autres versions consistent en une seule demi-sphère placée directement à la surface de l’eau d’une rivière, avec son ouverture dirigée vers le bas. Selon une légende ancienne, les sons émis dans cette configuration étaient spécifiquement conçus pour attirer l’attention des crocodiles et des chasseurs.
Tambour d’eau de bois évidé
Ce type de tambour d’eau est particulièrement répandu en Nouvelle-Guinée. Il est aussi dépourvu de membrane. Sculpté à partir d’une pièce de bois dur, il adopte l’apparence d’un sablier à deux extrémités ouvertes. À certaines occasions, il peut être pourvu d’une ou de deux poignées au-dessus de sa partie supérieure. Il est joué en frappant directement à la base, à la surface de l’eau. Le son qu’il génère est profond et sourd.
Tambour d’eau avec membrane
Le tambour d’eau avec membrane est un corps creux fabriqué en bois, en argile ou en métal. Son ouverture est recouverte d’une membrane attachée autour de la coque. Certains modèles comportent un orifice latéral, fermé hermétiquement par un bouchon. Il permet au musicien de réguler le niveau d’eau à l’intérieur du corps, sans nécessiter le démontage de la membrane. Il arrive que l’eau soit mélangée à des cendres, du tabac, du maïs ou du pollen de maïs, en fonction de leur signification cérémoniale.
Tambour d’eau sans instrument
Selon certains experts, les bungos et les liquindis, originaires respectivement du Venezuela et du Cameroun, appartiennent à la catégorie des tambours à eau. Ils se distinguent par l’absence de tout outil musical, l’eau étant elle-même l’instrument de musique. Les femmes s’immergent dans l’eau jusqu’à la taille et, avec leurs mains, produisent des sons en frappant la surface de l’eau à des vitesses et des forces variables. La position des mains (ouvertes, fermées ou semi-ouvertes) et la présence d’air entre ces dernières influencent le son produit.
L’usage du tambour d’eau sans instrument au Venezuela a été introduit depuis le Cameroun, terre d’origine des esclaves qui avaient déjà adopté cette pratique tambourinante depuis des siècles. Jusqu’à aujourd’hui, l’ethnie bantu maintient cette tradition. Cette coutume est aussi appliquée aux îles Banks, en Océanie.
Origine et histoire du tambour d’eau
L’histoire et l’usage du tambour d’eau sont diversifiés. Ils dépendent en grande partie de leur origine.
En Afrique
Le modèle africain est celui avec calebasses. Il est principalement répandu dans les savanes de l’Afrique de l’Ouest. Traditionnellement, cet outil musical était exclusivement réservé aux femmes. Cette pratique persiste encore dans les villages où il conserve son caractère rituel. Il se décline en plusieurs noms selon les régions, et s’emploie dans différents rituels :
- aki sumbu la hem dans la Haute-Volta, où il est placé près du défunt, et joué par deux femmes ;
- dansuomu au Ghana, en Côte d’Ivoire et par les Akans (peuple de l’Afrique de l’Ouest) ;
- dyi dunu au au Mali (peuple Bambara), où il est frappé pendant les mariages et les décès ;
- djidja gnoum ou djidja binngué en Côte d’Ivoire, notamment à Boroponko et Tissié, où il sublime les danses tchabinngué et soumogolo, exécutées pendant des funérailles et des cérémonies de mariage traditionnelles ;
- tembol au Tchad, par le peuple Kotobo ;
- trotrobe à Madagascar, utilisé pendant les cérémonies religieuses, où il est manipulé par des femmes pour invoquer les vazimbas, premiers habitants de l’île ;
- assakhalebo ou sakalobo au Niger, au Mali et au Tchad, où il est joué en accompagnement des chants par les femmes ;
- gi dunu par le peuple Sénoufo (Burkina Faso, Mali et Côte d’Ivoire) et Malinké (Guinée, Sénégal et Mali), où la grande calebasse est parfois remplacée par une cuvette en métal ;
- kèrèguè ou kèrè à Wélékéi (Côte d’Ivoire), en appui à la danse funéraire tchogoli tchogoli, ainsi que la tchabinngué ;
- hanchui et lou en Côte d’Ivoire, où il est employé lors de mariages traditionnels, notamment pour accompagner les danses hanchui et han-han, respectivement à Zaghala et à Boromba.
Dans d’autres sociétés, les deux sexes peuvent le manier pendant les circoncisions, les baptêmes, les mariages, les rites funéraires, les initiations et plus encore.
En Nouvelle-Guinée
Le tambour d’eau de la Nouvelle-Guinée est exclusivement destiné aux hommes. Cet instrument est employé lors des cérémonies d’initiation réservées à la gent masculine, excluant ainsi femmes et enfants.Il se décline en deux variétés. D’une part, l’Abuk waak, du peuple iatmul, émet un son étouffé, censé reproduire le bruit des initiés symboliquement engloutis par le crocodile surnaturel qui, ensuite, les régurgite. D’autre part, le kami ou kamikaula, est spécifique de la région centrale du Sepik. Il prend l’apparence d’un récipient ovale allongé et inversé. Durant les rituels, ils sont placés tête en bas dans un trou rempli d’eau, créant ainsi un son sourd distinct.