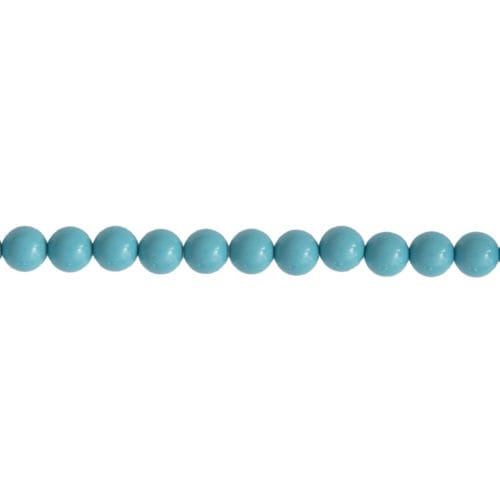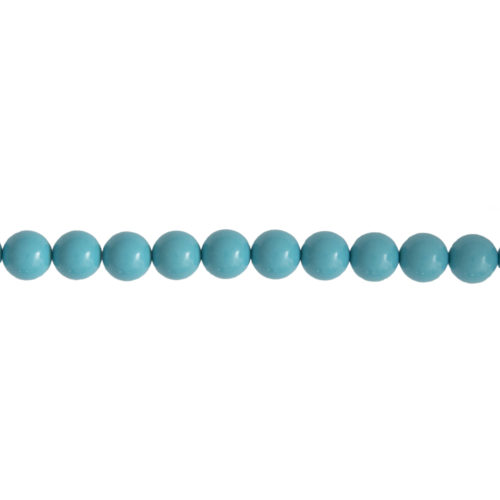Le « do »
Son corps, carré et plat, prend la forme d’un tambour, dont les deux côtés sont recouverts de peau de chien ou de chat. Les débutants se tournent vers la première option, car elle est souvent moins onéreuse et plus durable. En revanche, les joueurs professionnels préfèrent la peau de félin, car elle est plus délicate et propose un meilleur rendu sonore. Avec l’industrialisation, des modèles en plastique ont fait leur apparition.
Le bois de koki, arbre cultivé en Inde, est traditionnellement utilisé pour la fabrication du « do ». Cependant, le bois de rose, les bois de mûre, de coing chinois, de zelkova et de noix sont également employés.
Le « sao »
Cet instrument à trois cordes se démarque par son large manche de 62,5 cm, dépourvu de frettes. Ce dernier est plus fin, comparé à celui du banjo ou à celui de la guitare. Toutefois, son épaisseur varie selon le modèle choisi. Normalement composé d’une seule pièce (nobezao) en bois de rose ou en ébène, le sao est parfois divisé en trois éléments qui s’assemblent. Il s’agit du kamizao, du nakazao et du shimozao, dont l’ensemble forme le mitsuore (triple). De cette manière, il se démonte, se range et se transporte facilement. Le manche transcende le corps de l’instrument et fait office d’ancrage pour les cordes. Fines et longues, les chevilles sur lesquelles elles sont enroulées sont de forme hexagonale.
Le « koma »
Les cordes distribuent les vibrations vers les peaux à partir du chevalet. Ce dernier a pour rôle de partager le son et de l’amplifier. Les chevalets se déclinent sous diverses tailles et formes. Ils sont aussi proposés en différents matériaux, dont les plus estimés sont le bois de rose, le fanon de baleine, la corne de buffle d’eau et l’ivoire. Ces matières ont été abandonnées au profit du bambou, du plastique et de l’ébène qui sont des ressources moins rares. Le koma en ivoire est l’outil de prédilection des Tate-jamisen ou professeurs de samisen. Il produit un son amplifié, particulièrement recherché. Pour les étudiants, le shari ou ox-bone est le modèle à privilégier.
L’histoire et l’origine du shamisen
Le shamisen puise ses origines dans le « sanxian », un instrument chinois à trois cordes enveloppé dans une peau de serpent. Il est introduit dans le royaume de Ryūkyū au sud du Japon au XVIe siècle. Ce dernier se prononce sanshin dans la langue d’Okinawa, et est devenu un instrument emblématique de la musique traditionnelle, accompagnant les chants narratifs et lyriques. Aucune distinction n’a été retenue entre le sanxian et le sanshin. Pourtant, la caisse de résonance du sanshin actuel est beaucoup plus grande et plus ronde.
Vers le XVIIe siècle, il est apparu dans les autres îles de l’archipel japonais grâce au commerce maritime. La peau de serpent a été remplacée par celle du chien ou du chat, car il était difficile de s’en procurer. Au bout de 30 ans, le nom shamisen a été adopté et sa forme de base a été établie. Le samisen et le sanshin sont maintenant deux instruments distincts.
Les plus anciennes versions étaient fabriquées à Kyoto sur ordre de Toyotomi Hideyoshi. Bien que l’instrument fût difficile à maîtriser, les geishas s’entraînaient rigoureusement pour des prestations de divertissement à destination de leur clientèle aisée.
L’instrument de musique est devenu incontournable pour le kabuki, une forme de théâtre traditionnel au Japon. Actuellement, le samisen se fond dans différents styles de musique comme le rock. Les groupes Wagakki Band ou ROA (Relic Of Ancestor) en sont les pionniers. L’utilisation du kabuki dans la musique actuelle démontre le caractère intemporel de l’instrument.