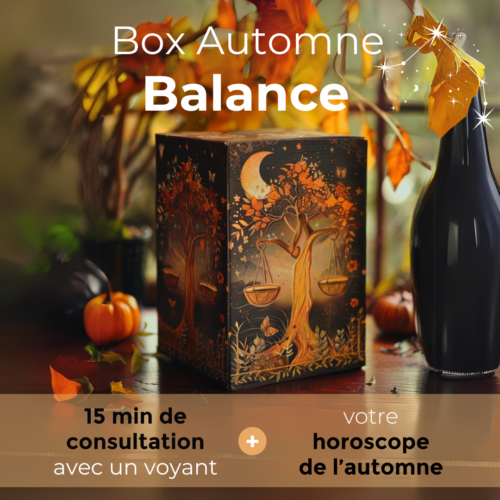Fonctionnement du rouleur
Le rouleur fonctionne de la même façon que tous les instruments de la famille des membranophones, comme le djembé ou le tambour bélé, entre autres. Sa facture a évolué, mais le principe de base demeure inchangé.
Auparavant, le roulèr était directement taillé dans un tronc de bois de 70 cm minimum. La membrane est tendue sur une extrémité au moyen de colle ou de clous. Les facteurs d’instruments de l’époque n’enlevaient pas les poils sur la peau de l’animal. Le joueur de rouleur avait coutume de chauffer la membrane près d’un feu avant d’exécuter des roulements. Cette astuce faisait ressortir une meilleure sonorité.
Le tonneau
De nos jours, les artisans privilégient des tonneaux en lamelles de bois pour confectionner le houleur. Ce changement au niveau du matériau apporte des modifications notables sur plusieurs points, dont le diamètre de l’instrument et celui de la membrane.
En moyenne, les roulèrs disponibles sur le marché font environ 50 cm de haut sur 40 cm de diamètre. Les fûts utilisés ont une capacité de 60 L, et sont cintrés sur les deux côtés et au milieu par des cercles de fer. Il s’avère parfois nécessaire de poncer ces derniers, puis de les remettre pour resserrer les lames.
La facture reprend le système de tensions des tambours afro-cubains ainsi qu’une technique de cordage à la main. De cette façon, il est possible de régler quelques accords en cas de besoin. Des cordes tressées recouvrent le bois sur la partie du montage de la peau. Elles sont insérées dans des trous préalablement percés dans la barrique. Dans certains cas, il se révèle plus judicieux de couper le haut du tonneau pour en arrondir les bords. Les finitions varient selon les préférences du fabricant. Certains appliquent du vernis ou de la peinture sur le fût. D’autres se contentent de recouvrir avec de l’huile de lin pour protéger le bois.
La peau
Cette étape passe après la préparation de la barrique du roulèr. Le disque de peau est découpé dans les mêmes dimensions que le diamètre du tonneau. Le fabricant perce ensuite des trous sur le pourtour de cette membrane. Ces derniers servent à accueillir la corde. La peau ainsi préparée est ensuite plongée dans l’eau, et est laissée tremper dans ce liquide durant une nuit. Le lendemain, elle est prête à être posée sur le fût. Après, il convient de passer le cordage autour pour terminer le montage. Les artisans disposent de leurs propres techniques, mais toutes visent la même finalité : un montage solide et bien droit. Vient finalement l’étape du serrage du cordage, idéalement pendant que la peau est encore humide. De cette manière, le rouleur obtenu se démarque par sa raideur.
Apprentissage du rouleur
Pour jouer de cet instrument, le batèr roulèr :
- place le tambour en position horizontale ;
- s’assoit dessus à califourchon ;
- positionne la membrane entre ses cuisses ;
- maintient éventuellement le houleur avec une cale ;
- incline le buste vers l’avant ;
- frappe avec les deux mains nues, parfois accompagnées du talon pour varier le rythme.